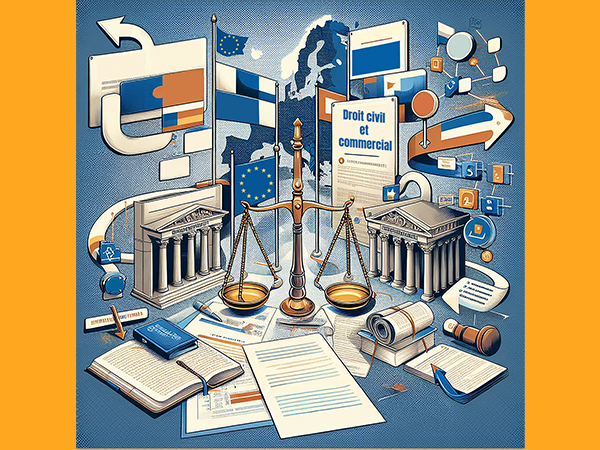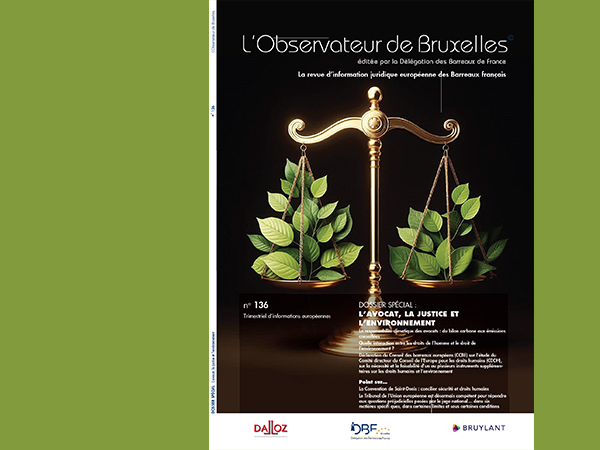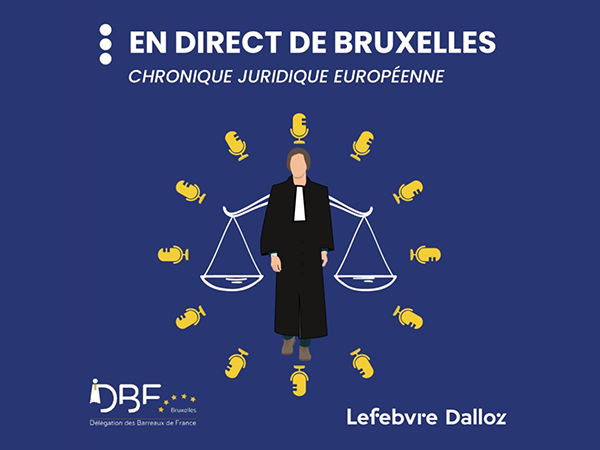| FISCALITE
Taxes indirectes supplémentaires / Droits d’accises
Les dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, doivent-elles être interprétées en ce sens que l’existence d’un mécanisme légal de répercussion de l’impôt sur le consommateur final d’un produit soumis à accise implique à lui seul l’existence d’un lien direct et indissociable entre cet impôt et la consommation de ce produit, de sorte qu’il doive être considéré comme une taxe indirecte supplémentaire au sens de de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, même dans le cas où cet impôt est calculé indépendamment de la quantité de produit effectivement consommée ?
Les dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une imposition, telle que la contribution tarifaire d’acheminement, qui est assise sur la part fixe des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité, à l’exclusion de la part variable de ces tarifs, seule à dépendre de la consommation d’électricité, mais qui est due à raison des contrats d’accès au réseau conclus par les consommateurs ou leurs fournisseurs, présente un lien direct et indissociable avec la consommation d’électricité, de sorte qu’elle doive être regardée comme une taxe indirecte supplémentaire au sens de ces dispositions ? |
Conseil d’Etat n°476000 06/12/2024 Accorinvest T-653/24 :
Accorinvest, n°476000 – Renvoi à la CJUE Aff. T-653/24
(6 décembre 2024) | Dans le litige au principal, les deux sociétés requérantes ont demandé à la juridiction de renvoi de prononcer l’annulation de plusieurs décisions par lesquelles une cour d’appel administrative a refusé de leur verser une indemnité compensatrice après que ces dernières se sont vues imposer une contribution forfaitaire d’acheminement jugée indue au titre de leurs activités de transport d’électricité, en application des dispositions nationales relatives au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
Cette contribution d’acheminement est assise sur la part fixe des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité, laquelle dépend du domaine de tension et de la puissance souscrite, et non de la part variable des tarifs d’utilisation, laquelle est fonction de la quantité d’énergie consommée.
Les requérantes estiment que cette contribution tarifaire ne respectait pas les conditions fixées par l’article 1 paragraphe 2 de la directive 2008/118/CE, relatif à la faculté, pour les Etats membres, de procéder au prélèvement de « taxes indirectes supplémentaires » sur la consommation de certains produits déjà soumis à des droits d’accises. La juridiction d’appel a quant à elle estimé qu’il n’existait pas de lien direct et indissociable entre cette contribution et la consommation d’électricité et qu’elle pouvait de fait être qualifiée d’impôt indirect frappant directement ou indirectement la consommation.
Devant la juridiction de renvoi, les requérantes soutenaient que la contribution avait la qualité d’impôt indirect frappant directement ou indirectement la consommation, au motif que le droit national prévoit un mécanisme légal de répercussion de cet impôt sur le consommateur final, sachant que son montant à ce stade ne sera pas calculé sur la quantité d’énergie consommée mais simplement sur la part fixe des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité.
Elles soutenaient également qu’il existait un lien direct et indissociable entre la contribution et la consommation d’électricité aux motifs que, d’une part, le contrat d’accès au titre duquel elle est due est adossé à un contrat de consommation et, d’autre part, que la part fixe des tarifs d’utilisation des réseaux publics sur laquelle celle-ci est assise, dépendent en substance de la puissance des installations, lesquelles dépendent in fine de la quantité d’énergie consommée. |
 | RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS
Coopération douanière / Restrictions quantitatives à l’importation / Emballage
Les étiquettes directement apposées sur les fruits et légumes constituent-elles, en toute hypothèse, des emballages au sens de l’article 3 de la directive 94/62 du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et déchets et de l’annexe I à cette directive ? |
Conseil d’Etat n°466929 du 08 novembre 2024 dans l’affaire Interfel C-772/24 :
Interfel, n°466929 – Renvoi à la CJUE Aff. C-772/24
(8 novembre 2024) | Dans l’affaire au principal, l’association interprofessionnelle des fruits et légumes frais a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet implicite opposée par la Première ministre à la demande d’abrogation du tiret 2 du paragraphe 3 de l’article 1 du décret n°2020-1724 interdisant l’élimination des stocks de produits alimentaires invendus et prévoyant diverses mesures contre le gaspillage.
L’association soutenait que l’article 80 de la loi AGCEC du 10 février 2020 dont est issue la disposition règlementaire litigieuse, avait été adopté sans faire l’objet d’une notification à la Commission européenne, en méconnaissance d’une série de dispositions issues : de la directive (UE) 2015/1535 ; de la directive 94/62/CE relative aux emballages et déchets ; du règlement (UE) 2011/1169 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
Elle soutenait également que la disposition litigieuse était en tant que telle contraire aux articles 34 et 35 TFUE en ce qu’elle constituait une restriction quantitative à l’importation non nécessaire, injustifiée et disproportionnée.
Après avoir déclaré comme infondés les moyens tirés de la méconnaissance des obligations de notifications issues de la directive (UE) 2015/1535 et du règlement (UE) 2011/1169, la juridiction de renvoi relève toutefois qu’eu égard aux conditions fixées par l’article 3 de la directive 94/62/CE et permettant de caractériser la notion « d’emballage », les étiquettes visées par l’article 80 de la loi AGCEC du 10 février 2020, dont l’un des décrets d’application est contesté dans le litige au principal, pourraient ne pas satisfaire aux éléments de qualification proposés aux points a), b) et c). i, ii et iii dudit article.
Conformément à ces dispositions, sont considérés comme des emballages, les dispositifs conçus de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur ; ceux conçus de manière à constituer au point de vente un groupe d’un certain nombre d’unités de vente ; ceux conçus de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages groupés en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L’article dispose toutefois que l’annexe I contient des exemples de dispositifs qualifiés d’emballage et illustrant l’application de ces critères.
Elle remarque cependant que l’annexe I du règlement 94/62/CE propose, afin d’illustrer le critère fixé au point iii, les exemples suivants : « les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit (…) ».
Or, la juridiction de renvoi estime qu’il subsiste un doute quant à la question de savoir si les dispositifs visés à l’annexe I constituent nécessairement et en tant que tel, des emballages ou alors, s’ils le sont que pour autant qu’ils remplissent les conditions et les éléments fixés à l’article 3 de la directive 94/62/CE.
La juridiction de renvoi estime in fine qu’une telle question est déterminante pour la solution du litige et présente une difficulté sérieuse. |
 | FISCALITE
Taxe sur le chiffre d’affaires / Art
Les dispositions du b) du paragraphe 1 de l’article 316 de la directive du 28 novembre 2006, combinées à celles du 2) du paragraphe 1 de son article 311 et à celles de son annexe IX, partie A, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’une personne morale telle qu’une société soit regardée, au sens et pour l’application de ces dispositions, comme « l’auteur » d’un tableau ?
En cas de réponse négative à la première question, quels critères doivent être pris en compte pour admettre qu’une personne morale telle qu’une société puisse être regardée, au sens et pour l’application de ces mêmes dispositions, comme « l’auteur » d’un tableau (tels que, dans le cas d’une société, la soumission de la société à un régime juridique particulier, la détention par la personne physique ayant peint le tableau de tout ou partie du capital social de la société, l’exercice par cette personne de fonctions de direction au sein de la société…) ? |
Conseil d’Etat n°465963 du 20 juin 2024 dans l’affaire Galerie Karsten Greve C-433/24 :
Galerie Karsten Greve, n°465963 – Renvoi à la CJUE Aff. C-433/24
(20 juin 2024) | Dans l’affaire au principal, la société requérante contestait le refus par la juridiction d’appel d’appliquer un régime optionnel de taxation sur la marge bénéficiaire qu’elle avait réalisée à la suite de l’achat de tableau auprès d’une société londonienne, avant que celui-ci ne soit revendu.
Conformément à l’article 316 de la directive 2006/112/CE, lu en combinaison avec les articles 297 A) ; B) et 278-0 bis du Code général des impôts, le droit d’opter pour le régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire prévue par ces dispositions est applicable à des livraisons d’objets d’art effectuée par leur auteur ou ses ayants droit, ainsi qu’à celles consécutives à une acquisition intracommunautaire réalisée auprès de leur auteur ou de ses ayants-droits.
La juridiction d’appel avait toutefois considéré que la revente d’un tableau, par une société dans laquelle son auteur disposait de la qualité d’associé, ne saurait être considérée comme étant réalisée par « l’auteur » de l’œuvre au sens des dispositions précitées. D’après elle, la notion d’auteur ne désigne que l’artiste, personne physique, qui en est à l’origine. Le revendeur étant une personne morale, la juridiction d’appel a considéré que les conditions posées par les dispositions précitées ne pouvaient s’appliquer.
Dans ce cadre, la juridiction de renvoi estime qu’afin de pouvoir trancher le fond du litige au principal, il importe au préalable de déterminer, d’une part, si les dispositions en cause doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’une personne morale telle qu’une société soit regardée, au sens et pour l’application de dispositions précitées, comme « l’auteur » d’un tableau et en cas de réponse négative, d’autre part, quels doivent être les critères d’appréciation à retenir afin de déterminer si une personne morale est effectivement « l’auteur » d’une œuvre ayant fait l’objet de l’opération de revente donnant lieu à imposition. |
 | LIBRE CIRCULATION DES SERVICES
Liberté d’établissement / Protection de la diversité culturelle
Les dispositions de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles excluent du champ d’application de celle-ci une mesure nationale régissant l’exercice, sur le territoire de l’Etat membre, d’une activité de service en vue de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle ou doivent-elles, combinées avec celles de l’article 16, paragraphe 1 b), de la même directive, être interprétées en ce sens que la préservation ou la promotion de la diversité culturelle est susceptible de justifier une dérogation à l’interdiction de soumettre les prestataires établis dans un autre Etat membre à une exigence instaurée par une telle réglementation nationale ?
L’appréciation de la compatibilité d’une telle réglementation nationale avec les objectifs poursuivis par la directive 2006/123/CE est-elle exclusive du même examen au regard du droit primaire de l’Union européenne ?
Dans l’hypothèse où il conviendrait d’apprécier la compatibilité d’une mesure nationale adoptée en vue de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle avec les libertés garanties par les articles 34 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une mesure nationale qui fixe un tarif minimal pour la livraison à domicile d’un bien doit-elle être regardée comme portant sur une modalité de vente de ce bien et, par suite, être appréciée au regard de la seule libre circulation des marchandises ou convient-il d’apprécier cette réglementation au regard de la seule libre prestation de services, notamment, eu égard à l’atteinte portée à l’activité de vente de ce bien en ligne ou au caractère distinct de la prestation de livraison par rapport à la prestation de vente du bien ? |
Conseil d’Etat n°474398 22/05/2024 dans l’affaire Amazon EU C-366/24 :
Amazon EU, n°474398 – Renvoi à la CJUE Aff. C-366/24
(22 mai 2024) | Dans l’affaire au principal, la société requérante a introduit un recours auprès du Conseil d’Etat, afin d’obtenir l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 4 avril 2023 relatif au montant de la tarification du service du livre aux motifs, d’une part, que la loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs méconnaissait les objectifs de la directive 2000/31/CE et de la directive 2006/123/CE d’une part, ainsi que le principe de libre circulation des marchandises d’autre part.
La société requérante soutient en effet que certaines dispositions de l’arrêté attaqué allaient à l’encontre de la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre, en ce qu’elles subordonneraient le libre exercice d’une activité de service à une exigence incompatible avec les conditions fixées à l’article 16, paragraphe 1 de la directive 2006/123/CE.
Aux termes de l’article 1er de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur : « 1. La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l’exercice de la liberté d’établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services. / (…) / 4. La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou au niveau national, dans le respect du droit communautaire, en vue de la protection ou de la promotion de la diversité culturelle ou linguistique, ou du pluralisme des médias ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 16 de la même directive : « Les Etats membres respectent le droit des prestataires de fournir des services dans un Etat membre autre que celui dans lequel ils sont établis. / L’Etat membre dans lequel le service est fourni garantit le libre accès à l’activité de service ainsi que son libre exercice sur son territoire. / Les Etats membres ne peuvent pas subordonner l’accès à une activité de service ou son exercice sur leur territoire à des exigences qui ne satisfont pas aux principes suivants : / a) la non-discrimination (…) ; / b) la nécessité : l’exigence doit être justifiée par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement ; / c) la proportionnalité (…) »
La juridiction de renvoi s’interroge donc sur l’articulation entre ces deux articles, notamment afin de déterminer s’il doit être entendu que les mesures nationales régissant l’exercice sur le territoire de l’Etat membre d’une activité de service en vue de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle sont exclues du champ d’application de la directive, ou si l’objectif de protection ou de promotion de la diversité culturelle doit être considérée comme un motif justifiant qu’il soit dérogé à l’interdiction de soumettre les prestataires établis dans un autre Etat membre à une exigence instaurée par une telle réglementation nationale.
Par ailleurs, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si une disposition nationale adoptée en vue de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle est compatible avec les articles 34 et 56 TFUE. Une telle appréciation implique de déterminer si, lorsqu’elle a pour objet la fixation d’un prix minimal pour la livraison d’un livre, une telle mesure doit être regardée comme portant sur une modalité de vente et ainsi être appréciée au regard de la liberté de circulation des marchandises, ou si elle doit être regardée comme relevant de la fourniture de services, en tenant compte notamment du caractère distinct de la fourniture du service de livraison, du service de vente du livre. |
 | LIBRE CIRCULATION DES SERVICES
Liberté d’établissement /Service de la société d’information / Services électronique d’aide à la navigation
L’interdiction faite aux exploitants d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs et susceptibles de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire à certains contrôles routiers doit-elle être regardée comme faisant partie du « domaine coordonné » tel que prévu par la directive 2000/31/CE, alors que, si elle concerne l’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information, en ce qu’elle porte sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, elle ne concerne cependant ni l’établissement des prestataires, ni les communications commerciales, ni les contrats par voie électronique, ni la responsabilité des intermédiaires, ni les codes de conduite, ni le règlement extrajudiciaire des litiges, ni les recours juridictionnels et la coopération entre États membres, et ne porte donc sur aucune des matières régies par les dispositions d’harmonisation de son chapitre II ?
Une interdiction de rediffusion qui a pour objet d’éviter notamment que des personnes recherchées pour des crimes ou délits, ou qui présentent une menace pour l’ordre ou la sécurité publics, ne puissent se soustraire à des contrôles routiers entre-t-elle dans le champ des exigences relatives à l’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information qu’un Etat membre ne pourrait imposer à des prestataires en provenance d’un autre État membre alors que le considérant 26 de la directive précise que celle-ci ne prive pas les Etats-membres de la faculté d’appliquer leurs règles nationales de droit pénal et de procédure pénale pour engager toutes les mesures d’enquêtes et autres nécessaires pour détecter et poursuivre les infractions en matière pénale ?
L’article 15 de la directive 2000/31/CE, qui interdit que soit imposée aux prestataires de services qu’il vise une obligation générale en matière de surveillance, hormis les obligations applicables à un cas spécifique, doit-il être interprété en ce sens qu’il ferait obstacle à l’application d’un dispositif qui se borne à prévoir que puisse être imposé aux exploitants d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de ne pas rediffuser ponctuellement, dans le cadre de ce service, certaines catégories de messages ou d’indication, sans que l’exploitant n’ait pour cela à prendre connaissance de leur contenu ? |
Conseil d’Etat, n°453763 8 mars 2024, dans l’affaire Coyote System, C-190/24 :
Coyote System, n°453763 – Renvoi à la CJUE Aff. C-190/24
(8 mars 2024) | Dans le litige au principal, la société requérante contestait la légalité d’un décret adopté sur le fondement de la loi d’orientation des mobilités, laquelle a notamment pour objectif de prévenir les comportements d’évitement des contrôles routiers qui seraient facilités par des services électroniques d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation et qui peuvent permettre d’anticiper un contrôle et s’y soustraire.
En particulier, le requérant contestait la légalité externe et interne du décret, au motif notamment que le dispositif d’interdiction de rediffusion précisé par le décret méconnaîtrait les objectifs de la directive 2000/31/CE, ainsi que son article 15, en ce qu’un tel dispositif impose aux exploitants d’un service électronique d’aide à la navigation ou à la conduite par géolocalisation une obligation générale de surveillance des informations qu’ils transmettent.
La juridiction de renvoi considère ainsi que la réponse à apporter à une partie des moyens soulevés dans le cadre du litige au principal fondées sur la compatibilité du décret avec certaines dispositions du droit de l’Union, dépend de la réponse à apporter à une série de questions préalables. |
 | LIBRE CIRCULATION DES SERVICES
Droit d’établissement / Protection des mineurs / Accès aux contenus pornographiques
En premier lieu, des dispositions relevant du droit pénal, notamment des dispositions générales et abstraites qui désignent certains agissements comme constitutifs d’une infraction pénale susceptible de poursuites, doivent-elles être regardées comme relevant du « domaine coordonné » par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 lorsqu’elles sont susceptibles de s’appliquer tant au comportement ,d’un prestataire de services de la société de l’information qu’à celui de toute autre personne physique ou morale, ou faut-il considérer, dès lors que la directive a pour seul objet d’harmoniser certains aspects juridiques de ces services sans harmoniser le domaine du droit pénal en tant que tel et qu’elle ne pose que des exigences applicables aux services, que de telles dispositions pénales ne sauraient être regardées comme des exigences applicables à l’accès et à l’exercice de l’activité de services de la société de l’information relevant du «domaine coordonné» par cette directive ? En particulier, des dispositions pénales destinées à assurer la protection des mineurs entrent-elles dans le champ de ce « domaine coordonné » ?
Le fait d’imposer à des éditeurs de services de communication en ligne de mettre en œuvre des dispositifs destinés à prévenir la possibilité pour des mineurs d’accéder aux contenus pornographiques qu’ils diffusent doit-il être regardé comme relevant du « domaine coordonné » par la directive 2000/31/CE, qui n’harmonise que certains aspects juridiques des services concernés, alors que, si cette obligation concerne l’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information, en ce qu’elle porte sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, elle ne concerne cependant ni l’établissement des prestataires, ni les communications commerciales, ni les contrats par voie électronique, ni le régime de responsabilité des intermédiaires, ni les codes de conduite, ni le règlement extrajudiciaire des litiges, ni les recours juridictionnels et la coopération entre États membres, et ne porte donc sur aucune des matières régies par les dispositions d’harmonisation de son chapitre II ?
En cas de réponse affirmative aux questions précédentes, comment doit s’opérer la conciliation entre les exigences résultant de la directive 2000/31/CE et celles qui découlent de la protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne, plus particulièrement de la protection de la dignité humaine et de l’intérêt supérieur de l’enfant, garantis par les articles 1er et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lorsque la seule adoption de mesures individuelles prises à l’égard d’un service donné n’apparaît pas de nature à assurer la protection effective de ces droits ? Existe-t-il un principe général du droit de l’Union européenne qui autoriserait les Etats membres à prendre, notamment en cas d’urgence, les mesures – y compris lorsqu’elles sont générales et abstraites à l’égard d’une catégorie.de prestataires de service – qu’impose la protection des mineurs contre les atteintes à leur dignité et à leur intégrité, en dérogeant lorsque cela est nécessaire, à l’égard de prestataires régis par la directive 2000/31/CE, au principe de régulation de ceux-ci par leur Etat d’origine posé par cette directive ? |
Conseil d’Etat, n°461193,461195, 8 mars 2023, dans l’affaire WebGroup Czech Republic et NKL Associates, C-188/24
WebGroup Czech Republic et NKL Associates, n°461193, 461195 – Renvoi à la CJUE Aff. C-188/24
(8 mars 2024) | Dans le litige au principal, les sociétés requérantes avaient introduit une requête par laquelle elles demandaient à la juridiction de renvoi d’annuler un décret édicté par le ministère de la Culture, fixant les modalités pratiques de mise en œuvre de mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites proposant des contenus pornographiques.
D’après les requérantes, les modalités ainsi que le contenu du décret contreviendraient à plusieurs dispositions et principes du droit de l’Union européenne. Les sociétés requérantes affirment notamment que l’acte attaqué est entaché d’un vice de forme, en ce qu’il aurait dû être notifié avant son adoption à la Commission européenne, qu’il était entaché d’incompétence négative en ce qu’il ne contiendrait aucune indication sur la nature de dispositifs techniques à mettre en œuvre, qu’il méconnait les principes de sécurité juridique et de proportionnalité et enfin, qu’il irait à l’encontre des objectifs de la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.
La juridiction de renvoi considère qu’eu égard aux prétentions des parties ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la directive telles qu’interprétées par la Cour de justice dans sa jurisprudence, il lui est nécessaire pour trancher le litige au fond que la Cour se prononce sur différents points d’interprétation des dispositions du droit de l’Union. |
 | FISCALITE
Autorisation de mise sur le marché / Médicaments à usage humain
Les articles 28 et 29 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 ( 1 ) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une juridiction d’un État membre concerné par une procédure décentralisée d’autorisation de mise sur le marché sans être l’État membre de référence, qui est compétente pour connaître d’un recours formé contre cette autorisation de mise sur le marché prise par l’autorité compétente de cet État membre conformément à ce qu’a jugé la Cour dans son arrêt du 14 mars 2018 Astellas Pharma (C-557/16), est compétente, dans cette hypothèse, pour vérifier que la procédure décentralisée a été conduite dans le respect des dispositions de la directive 2001/83/CE et que sa mise sur le marché ne présente pas de risque potentiel grave pour la santé publique au sens de l’article 29, paragraphe 1, de la même directive ? 2)
L’article 10 de la directive 2001/83/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce qu’une autorisation de mise sur le marché puisse être accordée à un médicament chimique selon la procédure simplifiée prévue à l’article 10, paragraphe 1, de cette directive lorsque son médicament de référence est un médicament biologique ? |
Conseil d’Etat, Décisions n° 462589, 462590, 462593, 462594, 19 février 2024 dans l’affaire Laboratoires Eurogenerics et Theramex France, C-118/24
Laboratoires Eurogenerics et Theramex France, n°462589, 462590, 462593, 462594 – Renvoi à la CJUE Aff. C-118/24
(19 février 2024) | Dans le litige au principal, les requérantes, un groupe de sociétés pharmaceutiques, ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir, une décision implicite du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) par laquelle ce dernier a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de plusieurs décisions prévoyant, d’une part, la création d’un nouveau groupe de médicaments génériques issus de diverses spécialités et, d’autre part, l’autorisation de la mise sur le marché de ces spécialités. Selon les requérantes, l’ANSM n’aurait pas suivi les procédures appropriées dans le cadre de la délivrance des autorisations de mise sur le marché.
Le Conseil d’Etat estime que la réponse à la contestation soulevée sur ce point par les requérantes dépend de la question de savoir si les dispositions de la directive 2001/83/CE font obstacle à ce qu’une autorisation de mise sur le marché puisse être accordée à un médicament chimique selon la procédure simplifiée prévue à l’article 10 paragraphe 1 de ladite directive, lorsque le médicament de référence est un médicament biologique. |
 | FISCALITE
Avocats / Obligation déclarative / Droit à un procès équitable / Droit au respect de la correspondance / Droit à la vie privée
L’obligation déclarative auprès de l’administration fiscale à laquelle sont tenus les avocats en tant qu’intermédiaire, lorsqu’ils interviennent au titre d’une mission juridictionnelle ou d’une mission d’évaluation de la situation juridique de leur client, est-elle contraire au droit de l’Union européenne ? |
Conseil d’Etat, n°448486 – Renvoi à la CJUE, Aff. C-398/21
(28 juin 2021) | Dans l’affaire au principal, le Conseil National des Barreaux, la Conférence des bâtonniers et l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, soulèvent l’incompatibilité de l’article 8 bis ter, §5 de la directive 2011/16/UE, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, avec le droit à un procès équitable, le droit au respect de la correspondance et le droit à la vie privée qui sont garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’homme. Les avocats intervenant au titre d’une mission juridictionnelle étant tenus par principe, en vertu du statut d’intermédiaire, à des obligations d’information fiscale dans un cadre transfrontière, le Conseil d’Etat saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin de savoir si la disposition est compatible avec le droit à un procès équitable. Il lui demande en outre si cette disposition est compatible avec les droits au respect de la correspondance et de la vie privée, les avocats étant également tenus par ces obligations lorsqu’ils exercent une mission d’évaluation de la situation juridique de leurs clients. |
 | CONSOMMATION
Voyage à forfait / Covid-19 / Conditions de remboursement
L’organisateur d’un voyage à forfait est-il tenu en vertu du droit de l’Union européenne de procéder à un remboursement intégral en argent dès lors qu’il résilie le contrat ou peut-il procéder à un remboursement en équivalence ? |
Conseil d’Etat, UFC – Que choisir et CLCV, n°441663 – Renvoi à la CJUE, Aff. C-407/21
(2 juillet 2021) | Dans l’affaire au principal, les requérants demandent l’annulation de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020, relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeur, qu’ils considèrent incompatible avec le droit de l’Union. Le Conseil d’Etat saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin d’obtenir des précisions sur la notion de « remboursement intégral » figurant à l’article 12 §4 de la directive 2015/2302, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyages. Il souhaite notamment savoir si cette notion doit être entendue comme s’agissant d’un remboursement en argent ou s’il peut notamment s’agir d’un remboursement en avoir. Dans le cas où cette notion s’entendrait exclusivement d’un remboursement en argent, le Conseil d’Etat demande à la Cour si, compte tenu de la crise sanitaire, le remboursement peut déroger au délai de 14 jours prévu par l’article 12 §4 de la directive. Enfin, dans le cas où le remboursement devrait intégralement être réalisé en espèce et qu’aucune dérogation au délai imposé ne serait autorisée, est-il possible de moduler les effets dans le temps d’une décision annulant un texte de droit national contraire à l’article 12 §4 de la directive ? |
 | RECHERCHE ET SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION
Hadopi / Lutte contre la reproduction illégale d’œuvres / Recueil des données d’identité civile / Contrôle et autorisation préalable
Un organisme chargé de la protection des œuvres et des droits d’auteur sur internet peut-il recueillir des données d’identité civile correspondant à une adresse IP sans contrôle et autorisation préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante conformément au droit de l’Union européenne ? |
La Quadrature du Net et autres, n° 433539 – Renvoi à la CJUE
(05 juillet 2021) | Dans l’affaire au principal, plusieurs associations ont saisi le Conseil d’Etat afin de faire abroger le décret définissant les modalités de recueil des informations personnelles attachées à une adresse IP par la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (« HADOPI »). En cas d’atteinte aux droits d’auteur et de reproduction illégale, cette autorité peut obtenir auprès des fournisseurs d’accès à internet les données d’identité civile des auteurs de manquements, afin de leur adresser une recommandation de respecter la loi. Les associations requérantes contestent ce décret en ce qu’il méconnaitrait la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Le Conseil d’Etat saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin de savoir si le recueil de données d’identité civile correspondant à une adresse IP est soumis à une obligation de contrôle et d’autorisation préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante dotée d’un pouvoir contraignant. Dans l’affirmative, le Conseil d’Etat se demande si un tel contrôle préalable peut être automatisé par un service indépendant et impartial à l’égard des agents chargés de recueillir les données mais interne à l’organisme (HADOPI). |
 | CONSOMMATION
Pratiques commerciales / Produits biocides / Protection de la santé et de l’environnement
Un Etat membre peut-il, en se fondant sur la protection de la santé publique et de l’environnement, prévoir des règles restrictives en matière de pratiques commerciales et la publicité des produits biocides en vertu du règlement (UE) 528/2012 concernant la mise sur le marché et l’utilisation de ces produits ? |
Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises et autres – Renvoi à la CJUE, aff. C-147/21
(8 mars 2021)
| Dans l’affaire en cause au principal, un Comité interprofessionnel a saisi le Conseil d’Etat afin de faire annuler un décret venant prohiber certaines pratiques commerciales comme les ristournes, les rabais ou la différenciation des conditions générales et particulières de vente. Ce décret a été pris sur les fondements des articles L. 522-18 et L. 522-5-3 du code de l’environnement qui, selon la requérante, méconnaîtrait l’étendue des pouvoirs réglementaires, introduit une discrimination injustifiée au profit d’autres produits, serait dépourvu de base légale et contraire au droit de l’Union européenne. Le Conseil d’Etat saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin de savoir si un décret venant interdire certaines pratiques commerciales et publicité sur des types de produit biocide au motif de la protection de la santé et de l’environnement est contraire à la réglementation européenne. En outre, dans la négative, le Conseil d’Etat aimerait savoir dans quelles mesures une telle interdiction est possible. |
 | DROIT GENERAL DE L’UE
Produits cosmétiques / Nature juridique d’un courrier d’un chef d’unité de la Commission européenne / Portée juridique
Le courrier d’un chef d’unité de la Commission européenne doit-il être regardé comme un acte préparatoire à la décision de la Commission déterminant si une mesure est justifiée ou non sur le fondement de l’article 27 du règlement (CE) 1223/2009 et sur lequel le juge national peut s’appuyer lorsqu’il est saisi de la légalité d’une mesure provisoire prise par une autorité nationale ? |
Décision Fédération des entreprises de la beauté – Renvoi à la CJUE, aff. C-4/21
(23 décembre 2020) | Dans l’affaire au principal, la fédération des entreprises de la beauté demande l’annulation d’une décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé faisant notamment valoir que cette décision est prise en contrariété du règlement (CE) 1223/2009. La décision avait été communiquée à la Commission européenne et en retour, un chef d’unité avait signalé par courrier l’absence de base légale de cette décision. Le Conseil d’Etat saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin de préciser la nature juridique d’un courrier d’un chef d’unité de la Commission européenne. Dans l’hypothèse où ce courrier ne doit pas être considéré comme un acte préparatoire mais comme une décision exprimant la position définitive de la Commission, peut-il être contesté devant le juge national, sans qu’il n’ait fait l’objet d’un recours en annulation devant la Cour de justice de l’Union européenne ? |
 | DROIT DES ETRANGERS
Handicap / Ressources suffisantes / Assurance maladie / Système d’assistance sociale / Obligation de quitter le territoire français (OQTF)
L’exigence d’une assurance maladie et de ressources suffisantes afin de pouvoir rester sur le territoire français sans être une charge pour le système d’assistance sociale conformément à la directive 2004/38/CE, constitue-t-elle une discrimination indirecte contraire aux articles 8 de la CEDH et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ? |
Décision du Tribunal administratif de Dijon, n°2100038 – Non publié sur Curia
(11 mars 2021) | Dans l’affaire au principal, un ressortissant belge demande au Tribunal administratif de Dijon d’annuler l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et d’enjoindre au préfet le réexamen de sa situation. Le requérant est atteint d’une incapacité à 80%, il ne justifie d’aucun emploi en France et perçoit l’allocation pour adultes handicapés. Selon le préfet, 60% de ses ressources provenant du système social français et celui-ci ne détenant pas d’assurance maladie, il ne dispose pas de ressources suffisantes afin de ne pas être une charge pour le système d’assistance sociale conformément aux articles L. 121-1 et R. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels sont une transposition exacte des articles 7 et 8 de la directive 2004/38/CE. Le Tribunal administratif de Dijon saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin de savoir si les dispositions en cause au principal constituent une discrimination indirecte à l’égard des personnes qui ayant un handicap, ne peuvent exercer une activité professionnelle ou uniquement de manière limitée, de manière à disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins. |
 | FISCALITÉ
Dividendes des filiales / Double imposition / Précompte immobilier
Une disposition nationale qui prévoit pour la correcte mise en œuvre d’un dispositif destiné à supprimer la double imposition économique des dividendes, un prélèvement lors de la redistribution par une société mère de bénéfices qui lui ont été distribués par des filiales établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne est-elle contraire à la directive 90/435/CE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents ? |
Décisions Schneider Electric, n° 442224 et 442248 – Renvoi à la CJUE Aff. C-556/20
(23 octobre 2020) | Dans l’affaire au principal, les sociétés requérantes soutenaient que les commentaires attaqués réitéraient les dispositions instituant le précompte mobilier de l’article 223 sexies du code général des impôts, lequel serait incompatible avec la directive. Le Conseil d’État saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin d’obtenir des précisions quant à la redistribution de bénéfices à une société mère par ses filiales établies dans un autre État membre de l’Union et la suppression de la double imposition économique des dividendes. En vertu de la jurisprudence de la Cour en effet, les articles 49 et 63 du TFUE s’opposent à une législation d’un Etat membre ayant pour objet d’éliminer la double imposition économique des dividendes, qui permet à une société mère d’imputer sur le précompte, dont elle est redevable lors de la redistribution à ses actionnaires des dividendes versés par ses filiales, l’avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes s’ils proviennent d’une filiale établie dans cet Etat membre. Or, il est allégué que le précompte mobilier a le caractère d’une mesure fiscale prévue par l’Etat membre d’une société mère prévoyant la perception d’un impôt à l’occasion de la distribution des dividendes par la société mère et dont l’assiette est constituée par les montants des dividendes distribués, y compris ceux provenant des filiales non-résidentes dans l’Etat membre de cette société. |
 | RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS
Analyse d’impact / Qualité des eaux / Impacts temporaires
La directive 2000/60/CE permet-elle aux Etats membres de ne pas prendre en compte, lorsqu’ils autorisent un programme ou un projet, les impacts temporaires de courte durée sans conséquences de long terme sur l’état de l’eau de surface ? |
Décision France Nature Environnement, n° 429341 – Renvoi CJUE Aff. C-525/20
(19 octobre 2020) | Dans l’affaire au principal, l’association requérante avait requis l’annulation pour excès de pouvoir d’un décret du 4 octobre 2018 prévoyant l’ajout d’un alinéa à l’article R. 212-13 du code de l’environnement un comportant les mots « il n’est pas tenu compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme ». Le Conseil d’Etat saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin d’obtenir des précisions quant à la prise en compte de l’impact d’un programme ou projet sur la qualité des masses d’eaux de surface. En effet, la jurisprudence de la Cour précise déjà la notion de détérioration de l’état d’une masse d’eau, les Etats membres étant tenus, en vertu de la directive et sous réserve de dérogations, de refuser l’autorisation d’un projet particulier lorsqu’il est susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou lorsqu’’il compromet l’obtention d’un bon état des eaux de surface ou d’un bon potentiel écologique et d’un bon état chimique de telles eaux à la date prévue par cette directive. Le cas échéant, quelles sont les conditions que les programmes et projets doivent remplir au sens de l’article 4 de la directive, en particulier §6 et §7. |
 | LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS
Reconnaissance des qualifications professionnelles / Santé
Un Etat membre peut-il instaurer un accès partiel à l’une des professions auxquelles s’applique le mécanisme de la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles prévu par les dispositions de la directive 2005/36/CE dans le domaine de la santé ? |
Décision Confédération Nationale des Syndicats Dentaires et a., n° 416964, 417078, 417937, 417963, 418010, 418013 et 419746 – Renvoi à la CJUE Aff. C-940-19
(30 décembre 2019) | Dans l’affaire au principal, les syndicats requérants ont formé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat en vue d’annuler le décret transposant la directive en droit français. Ils font valoir que les dispositions visées prennent illégalement en compte les professions bénéficiant du mécanisme de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles prévu par la directive, dans le champ d’application de l’accès partiel. La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’un renvoi préjudiciel et les conclusions de l’Avocat général Hogan ont été rendues le 1er octobre 2020.
|
 | RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS
Télécommunications / Station terrienne mobile / Unicité du matériel
Le Conseil d’Etat demande à la Cour de justice de l’Union européenne de préciser les critères juridiques permettant d’identifier une station terrienne mobile au sens de la décision 626/2008/CE concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite. |
Décision Société Eutelsat n° 420128 – Renvoi CJUE Aff. C-515/19
(8 juillet 2019) | Dans l’affaire au principal, une société de télécommunications demandait l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision de l’Autorité de régulation des communications électroniques qui n’aurait pas vérifié les conditions posées par la décision. Le Conseil d’Etat saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin de savoir si cette décision exige qu’une station terrienne mobile communiquant avec un élément terrestre complémentaire puisse, sans matériel distinct, communiquer avec un satellite. Dans l’affirmative, le Conseil d’Etat demande comment doit être appréciée l’unicité́ du matériel. En outre, dans l’hypothèse où il est avéré que l’opérateur sélectionné conformément au titre II de cette décision n’a pas respecté les engagements de couverture du territoire, les autorités compétentes des États membres doivent-elles refuser d’accorder des autorisations d’exploiter des éléments terrestres complémentaires ? En cas de réponse négative, le Conseil d’Etat également si lesdites autorités peuvent-elles choisir de refuser d’accorder ces autorisations. |