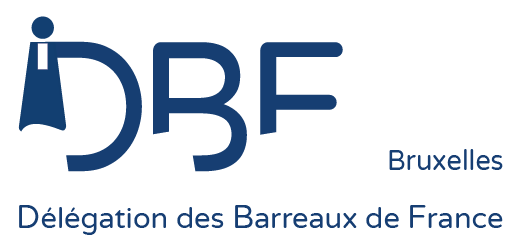Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 15 décembre dernier, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la liberté d’expression (Bono c. France, requête n°29024/11). Le requérant, avocat français, a été le défenseur d’une personne poursuivie pénalement en France pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et arrêtée en Syrie. Dans le cadre de l’instruction, un magistrat français s’est rendu en Syrie pour l’exécution de la commission rogatoire internationale pour auditionner le suspect. Dans ses conclusions écrites, le requérant sollicitait, d’une part, que soit retirées du dossier les pièces obtenues sous la torture des services secrets syriens et dénonçait, d’autre part, la complicité des magistrats instructeurs français pour ces actes de tortures. Après avoir de nouveau dénoncé cette complicité en appel, le requérant a fait l’objet de poursuites disciplinaires pour manquement aux principes essentiels d’honneur, de délicatesse et de modération régissant la profession d’avocat, lesquelles ont abouti à un blâme assorti d’une inéligibilité aux instances professionnelles pour une durée de 5 ans. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaignait d’une violation de son droit à la liberté d’expression du fait de sa sanction disciplinaire. La Cour rappelle que ce n’est qu’exceptionnellement qu’une limite touchant la liberté d’expression de l’avocat de la défense peut passer pour nécessaire dans une société démocratique. A cet égard, elle observe que les propos litigieux ont été formulés dans un contexte judiciaire et que l’accusation portait sur le choix procédural des magistrats de recourir à une commission rogatoire internationale alors que les méthodes d’interrogatoire des services secrets syriens étaient connues. Elle constate, d’ailleurs, que les juridictions nationales ont retiré les actes de la procédure établis en violation de l’article 3 de la Convention. Dans ce contexte, la Cour considère que les écrits litigieux participaient directement de la mission de défense du client du requérant. En outre, elle retient que les critiques du requérant, qui reposaient sur une base factuelle, ne sont pas sorties de la salle d’audience puisqu’elles étaient formulées dans des conclusions écrites. Elles n’ont donc pas pu porter atteinte à la réputation du pouvoir judiciaire auprès du grand public. Ainsi, la Cour estime que la sanction disciplinaire n’était pas proportionnée. Outre les répercussions négatives d’une telle sanction sur la carrière professionnelle d’un avocat, la Cour estime que le contrôle a posteriori des paroles ou des écrits litigieux d’un avocat doit être mis en œuvre avec une prudence et une mesure particulières. En effet, s’il appartient aux autorités judiciaires et disciplinaires de relever et sanctionner certains comportements des avocats, elles doivent veiller à ce que ce contrôle ne constitue pas pour ceux-ci une menace ayant un effet « inhibant », qui porterait atteinte à la défense des intérêts de leurs clients. Ainsi, en l’espèce, le requérant avait fait l’objet, en appel, d’un rappel à l’ordre, lequel a été considéré comme suffisant, les juges n’ayant pas estimé opportun de demander au procureur général de saisir les instances disciplinaires. Ce n’est que plusieurs mois après que le procureur général a initié une procédure disciplinaire. Dès lors, la Cour considère qu’en allant au-delà de la position ferme et mesurée de la cour d’appel pour infliger une sanction disciplinaire au requérant, les autorités ont porté une atteinte excessive à l’exercice de la mission de défense de l’avocat et, partant, conclut à la violation de l’article 10 de la Convention. (JL)