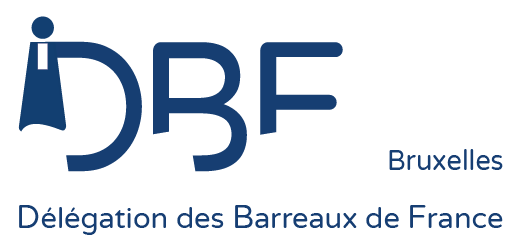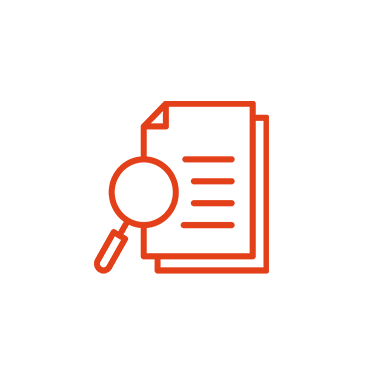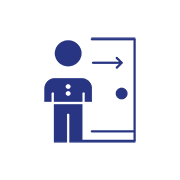| MESURES RESTRICTIVES
Mise à disposition des fonds / Entités publiques / Influence concurrente au gouvernement légitime
L’article 2.2 du règlement (UE) n 1352/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen doit-il être interprété, à la lumière des lignes directrices publiées par le Conseil, mises à jour le 4 mai 2018, en ce sens que la mise à disposition indirecte peut s’entendre de la mise des fonds à la disposition d’entités publiques non visées par les mesures restrictives, s’il est établi que les personnes visées par ces mesures exercent, au sein de ces entités, une influence concurrente de celle du Gouvernement légitime non visé par ces mesures ?
Lorsque l’existence de cette influence concurrente est établie, l’article 2.2 du règlement (UE) n 1352/2014 doit-il être interprété en ce sens que les entités à la disposition desquelles les fonds sont remis sont présumées contrôlées par les personnes visées par les mesures restrictives ? En cas de réponse positive, cette présomption admet-elle la preuve contraire ? A cet égard, la circonstance que le Gouvernement légitime, non visé par les mesures restrictives, ne coopère pas avec les personnes visées par ces mesures est-elle pertinente ?
Lorsque les éléments produits devant le juge national ne permettent pas d’apprécier si l’influence déterminante au sein de l’entité à la disposition de laquelle sont mis les fonds appartient au Gouvernement légitime ou aux personnes visées par les sanctions, le simple risque raisonnable que ces dernières bénéficient finalement de tout ou partie de ces fonds est-il suffisant pour appliquer les sanctions ? |
Cour de cassation n°G 22-13.596 du 6 décembre 2024 dans l’affaire DNO Yemen C-842/24 :
Pourvoi n°G 22-13.596 (ch. Civ), DNO Yemen – Renvoi à la CJUE Aff. C-842/24
(6 décembre 2024) | Dans l’affaire au principal, un groupe de sociétés spécialisées dans les opérations de forage, de raffinage, de transport et de vente de pétrole ont conclu avec le ministère du pétrole et des mines du Yémen des accords d’exploitation et de partage de production de pétrole et de gaz naturel, lesquels comportaient une clause d’arbitrage.
A la suite d’une sentence prononcée par une chambre de commerce internationale située à Paris, plusieurs sociétés contractantes ont formé un recours en annulation contre cette sentence les condamnant au paiement de dommages et intérêts au profit du ministère du pétrole et des mines et à la société Yemen Oil and Gas Corporation (YOGC).
Dans son arrêt, la cour d’appel de Paris a considéré qu’il revenait aux juridictions nationales de veiller à ce qu’en pareille situation, l’exécution d’une sentence arbitrale ne compromette pas l’interdiction fixée par le règlement (UE) 1352/2014du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen et complétée par le règlement 2015/878 du Conseil du 8 juin 2015, visant à ce que « Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ou utilisés à leur profit ».
Ainsi, elle estime que dans le cadre du contrôle de l’ordre public international, il lui appartient de s’assurer que la reconnaissance de la sentence arbitrale rendue en l’espèce ne contrevienne pas aux sanctions en permettant, « directement ou indirectement », la mise à la disposition de fonds à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste annexée au règlement (UE) 2014/1352.
La Cour d’appel a ainsi pu constater qu’il n’était pas possible de caractériser une prise de contrôle de la YOGC par la rébellion des Houthis et de fait, que l’exécution de la sentence n’entraînait pas la violation des interdictions posées en ce qu’elle aurait abouti à mettre à leur disposition des fonds au titre des dommages et intérêt dont le paiement a été décidé au titre de ladite sentence.
Devant la juridiction de renvoi, les sociétés contractantes estimaient quant à elles que l’exécution de cette sentence arbitrale, en ce qu’elle conduisait à la mise à disposition des fonds au profit de la société YOGC, conduisait à mettre indirectement à disposition des fonds ou des ressources économiques au profit d’une entité inscrite sur les listes (en l’espèce la milice Houthi) et ce, en méconnaissance de l’article 2.2 du règlement 2014/1352, lu à la lumière des articles paragraphes 55 bis, 55 ter, 55 quinquies des lignes directrices relatives aux sanctions, établies par le Conseil de l’Union européenne (mise à jour du 4 mai 2018), lesquels ne limitaient pas l’interdiction de mise à disposition directe aux seuls cas des personnes inscrites sur la liste, mais également aux cas de mise à disposition indirecte, qui pourrait profiter à une personne physique ou morale, entité ou organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement, même dépourvue de tout pouvoir de contrôle et d’instruction sur la société YOGC.
Ainsi se posait la question des critères matériels constitutifs de la mise à disposition indirecte des fonds, dans le cas de l’exécution d’une sentence impliquant le versement de sommes indemnitaires à des entités non inscrites sur les listes. Il s’agit en particulier de savoir si la condition de propriété ou de contrôle du bénéficiaire non inscrit est sine qua non afin de caractériser la mise à disposition indirecte, ou si celle-ci peut être réalisée en dehors de ces liens, en tenant compte de l’éventuelle influence qu’une entité inscrite peut exercer dans les structures de la société non inscrite à laquelle les fonds ont été mis à disposition. |
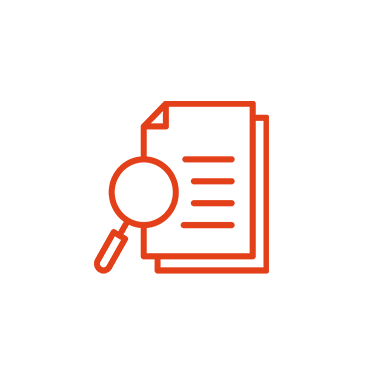 | ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE
Coopération en matière civile et commerciale / Clause abusive de juridiction
L’article 25 du règlement (UE) n 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’un contrat comporte une stipulation pour autrui, l’invocabilité, par le tiers bénéficiaire de cette stipulation, de la clause attributive de juridiction insérée dans ce
contrat, relève du droit applicable au contrat ou d’une règle matérielle tirée
de cet article ?
Dans la seconde hypothèse, l’article 25 du règlement Bruxelles I bis, doit-il être interprété en ce sens que lorsqu’une partie à un contrat souscrit un engagement à l’égard d’un tiers, la clause attributive de juridiction prévue par le contrat peut, quelle que soit la nature du contrat, être invoquée par le tiers contre les parties au contrat ?
L’article 25 du règlement Bruxelles I bis doit-il être interprété en ce sens que la clause attributive de juridiction, insérée dans un contrat qui définit une catégorie de bénéficiaires des engagements souscrits par les parties et fixe la procédure de désignation de ces bénéficiaires, est invocable, contre des parties au contrat, par un tiers, qui n’est pas nommément désigné par ce contrat et qui revendique la qualité de bénéficiaire de la stipulation pour autrui ?
L’article 25 du règlement Bruxelles I bis doit-il être interprété en ce sens que l’invocabilité d’une clause attributive de juridiction par le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui est subordonnée à l’indication expresse, dans le contrat, que la stipulation pour autrui s’applique à la clause attributive de juridiction ? |
Cour de cassation n°J 22-22.015 du 3 décembre 2024 dans l’affaire JMIB Holdings C-825/24
Pourvoi n°J 22-22.015 (ch. Civ), JMIB Holdings – Renvoi à la CJUE Aff. C-825/24
(3 décembre 2024) | Dans l’affaire au principal, le capital de la société JMIB société a fait l’objet d’un contrat de cession entre ses détenteurs (investisseurs institutionnels) et le président du directoire. Cet accord comprenait une clause prévoyant la rétrocession, par les investisseurs institutionnels, du montant de la transaction, au profit d’un ensemble de bénéficiaires dont l’identité ainsi que la quote-part respective devaient être déterminés par le président du directoire, en concertation avec un comité des rémunérations au sein duquel la société JMIB disposait d’un représentant. Enfin, l’accord de rétrocession prévoyait que le droit applicable était le droit français et la juridiction compétente le Tribunal de commerce de Paris.
Certains des bénéficiaires du contrat de rétrocession désignés a posteriori ont assigné la société JMIB devant les juridictions françaises en application d’une clause attributive de juridiction contenue dans l’accord de cession du capital.
A la suite de son assignation devant le Tribunal de commerce de Paris en raison du refus de la société JMIB d’exécuter le contrat de rétrocession, cette dernière souleva une exception de compétence des juridictions françaises, laquelle a systématiquement été rejetée par les juridictions de premier degré puis d’appel.
La société JMIB estimait que les bénéficiaires d’une stipulation pour autrui ne peuvent se prévaloir d’une clause attributive de juridiction. Elle soutenait que conformément aux articles 4, 7 et 25 du règlement 2012/1215 dit Bruxelles I Bis, qu’un bénéficiaire d’une stipulation pour autrui ne peut se prévaloir d’une clause attributive de juridiction que s’il est nommément désigné dans le contrat et si la clause fait elle-même l’objet d’une stipulation pour autrui.
La partie des bénéficiaires ayant assigné la société JMIB soutenaient que depuis l’arrêt C-201/82 Gerling Konzern Speziale Kreditversicherung AG e.a./Amministrazione del Tesoro dello Stato, les tiers bénéficiaires d’une stipulation pour autrui peuvent se prévaloir de l’ensemble des droits découlant de la stipulation pour autrui dans la mesure ou la Cour de justice n’a pas assimilée les bénéficiaire à des tiers au contrat, rendant inopérant le critère avancé par JMBI de la détermination préalable ou non de ces derniers.
La Cour s’interroge sur la portée de la décision Gerling précitée et se demande si celle-ci peut être étendue, en dehors du domaine de l’assurance, à tout tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui. Elle estime qu’un recours au mécanisme de demande de décisions préjudicielles est fondé en ce qu’à contrario, il reviendrait aux juridictions de chaque Etat membres d’apporter une réponse divergente à cette question, ce qui serait contraire aux objectifs d’unification et de prévisibilité des règles de compétences judiciaires poursuivis par le règlement Bruxelles I bis. |
 | SOCIAL
Loi applicable / Obligations contractuelles / Liberté de choix / Contrat individuel de travail
L’article 6 in fine de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit-il être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse du choix par les parties de la loi régissant le contrat de travail, le juge national doit écarter, en application du dernier membre de phrase de ce texte, les dispositions impératives, plus protectrices que celles de la loi d’autonomie, de la loi dont le travailleur demande l’application et qui serait applicable à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article, lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances qu’il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et le pays dont la loi a été choisie par les parties pour régir le contrat de travail ?
Dans l’affirmative, le juge national est-il tenu de prendre en considération les liens plus étroits résultant, dans l’exécution du contrat de travail, du choix de la loi applicable par les parties ou doit-il les écarter pour déterminer si les dispositions impératives de la loi d’un autre pays, revendiquées par le travailleur, sont applicables, en vertu du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention de Rome ? |
Cour de cassation n°B 20-17.055 du 6 novembre 2024 dans l’affaire Hortis C-768/24 :
Pourvoi n°B 20-17.055 (ch. Soc), Hortis – Renvoi à la CJUE Aff. C-768/24
(6 novembre 2024) | Dans le litige au principal, la société suisse Hortis a formé un pourvoi devant la juridiction de renvoi, à l’encontre d’une décision rendue par une juridiction d’appel, par laquelle celle-ci a reconnu que le licenciement d’un des employés de Hortis, ressortissant français travaillant en Suisse, était sans cause réelle et sérieuse, et a rejeté l’exception d’incompétence du juge français soulevée par celle-ci, la condamnant au paiement de sommes indemnitaires et de bonus au profit de son ancien employé ainsi que de Pôle emploi.
La cour d’appel a également retenu le droit français comme applicable, considérant que, conformément à l’article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la clause expresse et dénuée d’ambiguïté par laquelle les parties avaient choisi de placer leur contrat sous l’égide du droit suisse, ne pouvait avoir pour effet de déroger, d’une part, aux dispositions impératives du droit français et, d’autre part, des dispositions issues de la loi déterminée en application de l’article 6 § 2 de la convention. En application de cette disposition, le contrat peut être régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ou, si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
La juridiction d’appel avait considéré d’une part, que le lieu d’exécution du contrat se trouvait en France et, d’autre part, que les parties ne pouvaient déroger aux règles relatives à l’entretien préalable au licenciement et à l’obligation de motivation de la lettre de licenciement, le droit helvétique n’imposant pas de telle exigences à l’employeur.
Devant la juridiction de renvoi, la société Hortis soutenait en substance que la cour d’appel avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte, conformément au critère du « liens les plus étroits » prévu par l’article 6 § 2 de la Convention de Rome, des éléments et des circonstances censés rattacher l’exécution du contrat de travail à la Suisse, à savoir: la perception par le salarié d’une rémunération avantageuse en francs suisses versée sur un compte bancaire suisse, l’affiliation du salarié aux caisses sociales suisses, sa soumission au régime fiscal avantageux applicables aux salariés travaillant en Suisse, ou encore la détention d’une adresse e-mail et d’un numéro de téléphone portable suisses.
Selon elle, lorsque les juridictions nationales excluent la loi choisie par les parties au profit d’une loi dont l’identification résulte de la détermination, en application de l’article 6 § 2 de la Convention de Rome, du lieu d’exercice habituel du contrat, celles-ci doivent également démontrer que le contrat de travail n’entretenait pas de liens plus étroits avec un autre pays que celui d’accomplissement habituel du travail.
Le salarié défendeur considérait pour sa part que, d’une part, le choix d’une loi applicable au contrat ne dispensait pas les parties de se voir appliquer des dispositions impératives issues de la loi française et, d’autre part, que dans le cas où le contrat n’est pas exécuté habituellement dans un pays, la juridiction saisie est tenue également de rechercher si ce dernier n’entretient pas des liens plus étroits avec d’autres pays lorsque le salarié travaille de manière habituelle dans plusieurs pays à la fois.
La juridiction de renvoi s’interroge donc sur l’articulation entre les critères de détermination de la loi applicable prévu par les articles 3 et 6 de la Convention de Rome, dans le cas où l’une des parties soutient qu’en dépit du choix de la loi suisse, les dispositions impératives de droit français devraient pouvoir s’appliquer dans la mesure où, à défaut de choix, c’est bien la loi française qui aurait été déclarée applicable.
Plus précisément, la juridiction de renvoi se demande si, après avoir retenu que la loi applicable au contrat de travail avait été expressément choisie par les parties et constaté que le salarié accomplissait habituellement son travail en France, et si pour faire application des dispositions impératives de la loi française, plus protectrices en l’espèce que celles de la loi suisse, la juridiction nationale est tenue de rechercher, au regard des dispositions de l’article 6 de la convention de Rome et de la jurisprudence de la CJUE, l’existence de liens plus étroits avec la Suisse, y compris ceux résultant du choix, par les parties, de cette loi et, dans l’affirmative, si elle est tenue d’écarter les dispositions de la loi française dont le salarié sollicite l’application.
Selon la juridiction de renvoi, ni les articles 3 et 6 de la Convention de Rome ni la jurisprudence de la Cour de justice développée à cet égard ne permettent actuellement de déterminer si une juridiction est tenue, y compris en cas de choix de loi des parties, de procéder à l’analyse du critère des liens plus étroits que présenterait le contrat de travail avec la loi du pays choisie par les parties pour apprécier l’applicabilité au litige des dispositions impératives, plus protectrices, d’une autre loi. |
 | TRANSPORTS
Transporteur maritime / Responsabilité / Tourisme
Les articles 2, 3, paragraphe 1, et 7, premier alinéa, du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident et son annexe I doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils régissent la responsabilité d’un transporteur maritime, opérateur d’une croisière qui
présente les caractéristiques d’un forfait touristique au sens de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ?
En cas de réponse positive à la première question, ces dispositions du règlement régissent-elles la responsabilité de cet opérateur uniquement lorsque le dommage corporel se rattache au transport par mer ? |
Cour de cassation n°X 23-10.324 et n° X 23-13.383 (jonction) du 25 septembre 2024 dans l’affaire Costa Crociere e.a. C-629/24
Pourvoi n°X 23-10.324 et n°X 23-13.383 (ch. Civ), Costa Crociere e.a. – Renvoi à la CJUE Aff. C-629/24
(25 septembre 2024) | Dans plusieurs affaires au principal, deux juridictions d’appel ont fait une application divergente de certaines dispositions issues du règlement 392/2009 dans le cadre d’un litige portant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice subi dans le cadre d’un voyage à forfait par des voyageurs, lorsque ce voyage est organisé par un opérateur de croisière touristique.
La juridiction de renvoi constate d’une part, que la Cour de justice de l’Union européenne ne s’est toujours pas prononcée sur cette question et, d’autre part, que les juridictions nationales n’en font pas une interprétation identique des dispositions en cause. Les interprétations divergent essentiellement sur l’articulation du règlement 392/2009 avec la directive 90/134.
En effet, la cour d’appel de Versailles considérait que l’activité de transport par voie maritime telle que retenue dans le champ d’application ratione materiae du règlement, ne s’étend qu’aux seules prestations de transport de passagers, à l’exclusion d’éventuelles prestations d’hébergement. La combinaison de telles prestations constituant précisément la notion de « voyages à forfait » au sens de la directive 90/134. Ainsi, la cour d’appel de Versailles a considéré que le règlement 392/2009, établissait un régime de responsabilité et d’assurance applicable au transport maritime international de passagers par mer, à l’exclusion des contrats de transport conclus sur la base d’un prix forfaitaire combinant voyage et hébergement.
A l’inverse, la cour d’appel de Paris a estimé que le régime de responsabilité établi par le règlement s’étendait également aux prestations de transport maritime à forfait (croisière).
L’enjeu étant de déterminer si en l’espèce, la prestation de transport dans le cadre de laquelle les préjudices corporels sont survenus doit être considérée comme soumise au régime de responsabilité et d’indemnisation prévu par le règlement 392/2009.
La juridiction de renvoi constate que l’interprétation du règlement 392/2009 dont dépend l’issue du litige au principal ne s’impose pas avec une évidence telle, qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. |
 | SOCIAL
Loi applicable / Obligations contractuelles / Liberté de choix / Contrat individuel de travail
Les articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d’un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l’intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de manière durable en un lieu différent, destiné, selon la volonté claire des parties, à devenir un nouveau lieu de travail habituel ? |
Cour de cassation n°T 19-24.978 du 10 juillet 2024 dans l’affaire Locatrans C-485/24 :
Pourvoi n° T 19-24.978 (ch. Soc), Locatrans – Renvoi à la CJUE Aff. C-485/24
(10 juillet 2024) | Dans le litige au principal, une société contestait devant la juridiction de renvoi la décision d’une cour d’appel reconnaissant, d’une part, qu’un de ses salariés avait rapporté la preuve qu’il accomplissait l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur en France, et que dès lors, la loi française, à défaut de choix des parties, trouvait à s’appliquer en raison du lieu d’accomplissement habituel du travail, et, d’autre part, qu’il en résultait que le choix par les parties de la loi luxembourgeoise ne pouvait avoir pour résultat de priver ce salarié de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française, dont les règles tendant à protéger les salariés et celles relatives à la modification et la rupture du contrat de travail faisant partie.
Après avoir rappelé l’état de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’interprétation de la notion autonome de lieu où le travailleur « accomplit habituellement son travail » développée dans le cadre de la Convention de Bruxelles, la juridiction de renvoi indique que la société requérante considérait en substance que les critères d’appréciation d’un tel lieu dégagé dans le cadre de l’application de l’article 5 point 1 de la Convention devaient également s’appliquer dans le cadre d’un conflit de loi entraînant l’application de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de Rome.
Devant la juridiction de renvoi, la société requérante reprochait aux juges du fond d’avoir privé leur décision de base légale en faisant application de la loi française, sans rechercher si la France était le pays de travail habituel où le salarié avait accompli la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l’intégralité de sa période d’activité, ni s’il avait été décidé selon la volonté claire des parties que le salarié y exercerait de façon stable et durable ses activités.
Elle fait valoir que les dispositions des articles 3 et 6 de la Convention de Rome n’imposent pas au juge de prendre en considération l’intégralité de la période d’activité pour apprécier le lieu où le travail s’accomplit habituellement, point sur lequel la Cour de cassation considère par ailleurs qu’un doute raisonnable subsiste. De plus, la juridiction de renvoi souligne que si le critère du dernier lieu où le salarié accomplit habituellement son travail reste le plus pertinent pour déterminer quelle juridiction le salarié doit saisir, puisque cela lui permet d’intenter une action judiciaire à moindre frais, il n’est pas certain qu’il le soit également pour déterminer la loi applicable à défaut de choix.
En outre, la juridiction de renvoi indique que si les précisions apportées par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Heiko Koelzsch sur l’interprétation de la notion du lieu où le salarié accomplit habituellement son travail peuvent conduire, en application du principe favor laboris, à retenir le critère du dernier lieu où le salarié accomplit habituellement son travail, cependant, dans son arrêt Weber, la Cour de justice se réfère expressément à la prise en compte de « toute la durée de la relation de travail » sans reprendre le critère du dernier lieu où le salarié accomplit habituellement son travail. |
 | RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS
Licenciements collectifs / Motif économique
L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, selon lequel :
a) on entend par « licenciements collectifs » : les licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs lorsque le nombre de licenciements intervenus est, selon le choix effectué par les États membres :
i) soit, pour une période de trente jours :
– au moins égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs,
– au moins égal à 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs,
– au moins égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs ;
ii) soit, pour une période de quatre-vingt-dix jours, au moins égal à 20, quel que soit le nombre des travailleurs habituellement employés dans les établissements concernés, doit-il être interprété en ce sens que doivent être comptabilisés comme travailleurs dans le calcul des effectifs prévu par cette disposition les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux et travaillent habituellement dans l’entreprise utilisatrice au moment de la mise en œuvre de la procédure de licenciement ? |
| |
Cour de cassation n°F 22-10.903 d 13 juin 2024 dans l’affaire Hôtel Plaza C-419/24 :
Pourvoi n°F 22-10.903 (ch. Soc), Hôtel Plaza – Renvoi à la CJUE Aff. C-419/24
(13 juin 2024) | Dans l’affaire au principal, la société requérante s’est pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi à la suite d’un arrêt par lequel la juridiction d’appel a prononcé la nullité du licenciement d’une partie de ses employés pour motif économique en raison de l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi préalablement. La société a donc été contrainte de leur verser diverses sommes à titre d’indemnité pour licenciement nul, ainsi que des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, et s’est vu ordonner le remboursement des indemnités de chômage qui lui avaient été versées, dans la limite de six mois d’indemnités.
Devant la juridiction de renvoi, la requérante estimait que celle-ci avait fait une interprétation erronée de l’article L. 1233-61 du code du travail en incluant dans le décompte de l’effectif minimum de l’employeur au-delà duquel ce dernier est tenu d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, les travailleurs mis à sa disposition par des entreprises extérieures et ce, a contrario des prescriptions de l’article L. 1111-2 du code du travail fixant les modalités de décompte des effectifs applicables à l’ensemble des dispositions du code prévoyant une telle condition d’effectif.
La juridiction de renvoi constate que dans son arrêt Balkaya, aff. C-229/14 du 9 juillet 2015 portant sur l’application de la directive 98/59/CE, dont l’article 1 paragraphe 1 sous a) fixe les conditions permettant la qualification d’une mesure de licenciement collectif, la Cour de justice de l’Union européenne a reconnu que la notion de « travailleur » devait être appréhendée comme une notion autonome, au risque de permettre a contrario à chaque Etat membre d’interpréter et d’appliquer comme bon leur semble les seuils prévus par la directive, au risque d’altérer son champ d’application et de la priver de son plein effet.
La juridiction de renvoi reconnaît qu’il convient de demander à la Cour de justice de l’Union européenne si les salariés mis à disposition d’une entreprise par une entreprise extérieure doivent être considérés comme ayant la qualité de « travailleur » habituellement employé par l’entreprise utilisatrice, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998. |
 |
RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS
Droit de propriété intellectuelle / Marque / Tromperie effective
L’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques doit-il être interprété en ce sens que la mention d’une date de fantaisie dans une marque communiquant une information fausse sur l’ancienneté, le sérieux et le savoir-faire du fabricant des produits et, partant, sur une des caractéristiques non matérielles desdits produits, permet de retenir l’existence d’une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur ?
En cas de réponse négative à la première question, cet article doit-il être interprété en ce sens :
1. qu’une marque peut être considérée comme déceptive lorsqu’il existe un risque que le consommateur des produits et services qu’elle désigne croie que le titulaire de cette marque jouit d’une ancienneté séculaire dans la production de ces produits, leur conférant une image de prestige, alors que tel n’est pas le cas ?
2. que, pour que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur, dont dépend le constat du caractère déceptif d’une marque, il faut que la marque constitue une désignation suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée, de sorte que le consommateur visé soit amené à croire que les produits et les services possèdent certaines caractéristiques, qu’ils ne possèdent pas en réalité ? |
Cour de cassation n°D 22-11.499 du 13 juin 2024 dans l’affaire Fauré Le Page C-412/24 :
Pourvoi n°D 22-11.499 (ch. Com), Fauré Le Page – Renvoi à la CJUE Aff. C-412/24
(13 juin 2024) | Dans le litige au principal, la société requérante, dont l’activité consistait dans l’achat et la vente d’armes, de munitions et d’accessoires en cuir, contestait un arrêt d’appel rendu sur renvoi et ayant prononcé la nullité de deux marques qu’elle avait déposées au motif que celles-ci étaient trompeuses.
La juridiction d’appel considérait en effet qu’en reprenant le lieu et la date de création de la société, les dénominations choisies laissaient entendre qu’une transmission de savoir-faire s’était opérée et que l’activité de vente et d’achat des produits en cause s’était réalisée sans discontinuer depuis 1717.
Devant la juridiction de renvoi, la société requérante soutenait qu’en statuant ainsi, la juridiction d’appel avait notamment violé l’article L. 711-3, c), du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques. ».
La juridiction de renvoi constate à cet égard que la question ainsi soulevée devant elle porte sur la compatibilité de certaines dispositions nationales relatives aux conditions de validité de l’enregistrement d’une marque d’une part, et de l’article 3 paragraphe 1 sous g) de la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dont les dispositions figurent désormais à l’article 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
La juridiction de renvoi relève en effet que la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne relative à l’appréciation du caractère déceptif d’une marque sur le fondement de l’article 3 paragraphe sous g) directive 2008/95/CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et dont les dispositions figurent désormais à l’article 20, sous b), de la directive 2015/2436, ne permet pas de déterminer clairement l’incidence que serait susceptible d’avoir sur le choix du consommateur, la référence à l’ancienneté d’une marque.
Elle souligne que dans certains secteurs, comme celui du luxe, l’ancienneté serait susceptible de conférer un avantage concurrentiel au fournisseur des produits ou des services et une survaleur à la marque pouvant revendiquer une telle ancienneté, en raison du savoir-faire et de la qualité attendus d’une continuité de l’entreprise par le consommateur des produits ou services concernés.
Elle relève par ailleurs que la Cour de justice n’a toujours pas eu l’occasion d’entériner la position du Tribunal sur les dispositions en cause, ni de l’infirmer. |
 | ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE L’UNION EUROPEENNE
Actes juridiques de l’Union / Principe d’interprétation conforme / Législation d’un autre Etat membre
L’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA) approuvé par le Conseil de l’Union européenne par décision (UE) 2020/135 du 30 janvier 2020 doit-il être interprété en ce sens qu’une réglementation du Royaume-Uni transposant l’article 19 de la directive 2006/54/CE du Parlement et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en oeuvre du principe d’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail doit être considérée comme une réglementation d’un État membre transposant une directive par le juge qui statue après la fin de la période de transition dès lors que les faits sont antérieurs à cette date et/ou que l’instance a été engagée avant cette date ?
L’article 288 du TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, qui se trouve dans l’obligation d’appliquer le droit d’un autre État membre, doit procéder, sans qu’y fasse obstacle le principe de confiance mutuelle, à une interprétation des dispositions de ce droit conforme à une directive ?
Si la juridiction nationale estime impossible de procéder à une telle interprétation conforme, doit-elle comme elle le ferait pour son propre droit national, laisser inappliqué ce droit lorsqu’est en cause un principe général du droit de l’Union ou une disposition du droit primaire, concrétisés par une directive ? |
Cour de cassation n°D 21-21.615, du 14 mai 2024 dans l’affaire Crédit agricole corporate & Investment Bank C-350/24 :
Pourvoi n°D 21-21.615 (Ass. Plén), Crédit agricole corporate & Investment Bank – Renvoi à la CJUE Aff. C-350/24
(14 mai 2024) | Dans l’affaire au principal, le requérant, une salariée de la société Crédit agricole Corporate & Investment Bank (S.A) dont le contrat de travail était régi par le droit du Royaume-Uni, estimait que son placement en arrêt maladie résultait d’une discrimination fondée sur le sexe et était de ce fait constitutif de harcèlement moral.
Cette dernière a introduit un recours en indemnisation du préjudice subi devant le Conseil des prud’hommes, lequel rejeta ses demandes. La cour d’appel de Versailles rejeta également le recours, au motif que la requérante n’a pas été en mesure de rapporter les éléments de faits primaires constituant des circonstances pertinentes pouvant être prises en compte afin de déterminer l’existence des faits de discrimination allégués sur la base des éléments constitutifs prévus par les dispositions juridiques de droit anglais, applicables en l’espèce.
La requérante soutenait qu’en se prononçant ainsi, la juridiction d’appel s’était livrée à une interprétation de l’Equity Actnon conforme à certaines dispositions de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, notamment à son article 19, imposant au juge de procéder à une appréciation globale des faits.
En outre, le litige au principal impliquait, pour les juridictions nationales saisies en premier lieu, de mobiliser et d’interpréter une disposition nationale de transposition d’une directive, dans le cadre d’une procédure judiciaire introduite durant la période transitoire de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (soit entre le 1er février 2020 et le 31 décembre 2020) en tenant compte de ce que la décision rendue à l’issue de la procédure d’appel a été rendue postérieurement à la fin de ladite période de transition, une fois le Royaume-Uni sorti de l’Union. La juridiction de renvoi estime donc qu’il est nécessaire que certaines dispositions pertinentes de l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA) fassent l’objet d’une interprétation par la Cour de justice.
De plus, la juridiction de renvoi s’interroge sur la portée du principe d’interprétation conforme, en particulier son application par un juge d’un Etat membre à l’égard d’une disposition émanant du droit d’un autre Etat membre. A ce titre, l’avocat général de la juridiction de renvoi notait dans ses conclusions que la Cour de justice ne s’était jusqu’alors pas prononcée de manière explicite sur la portée du principe d’interprétation conforme, afin de déterminer si ce dernier implique que les juridictions des Etat membres sont tenues de le mettre en œuvre y compris lorsque ces dernières sont amenées à interpréter le droit d’un autre Etat membre.
La Cour de cassation considère qu’afin de garantir le respect par l’État français du droit de l’Union européenne, il est nécessaire, au préalable, de déterminer si une juridiction nationale est tenue d’appliquer le principe d’interprétation conforme, y compris à l’égard d’une disposition issue du droit d’un autre État membre.
Selon elle, une telle question serait d’autant plus fondée qu’elle observe, d’une part, que la jurisprudence de la Cour (arrêt C-152/84 Marshall, du 26 février 1986, point 48, arrêt C-106/89 Marleasing, du 13 novembre 1990, point 8) établit clairement l’obligation pour les Etats membres de garantir l’effectivité d’une directive, au besoin par l’application du principe d’interprétation conforme par les juridictions nationales et, d’autre part, que cette obligation pourrait éventuellement s’étendre aux dispositions issues du droit d’un autre Etat membre.
Elle mentionne que la Cour a admis dans ses arrêts C-519/19 Ryanair, du 18 novembre 2020 (point 51), et C-247/21 Luxury Trust Automobil, du 8 décembre 2022, (point 67) que les juridictions saisies d’un litige étaient tenues d’appliquer la législation de l’État dont les juridictions sont désignées [dans une clause attributive de juridiction], en interprétant cette législation conformément au droit de l’Union, et notamment d’une directive […].
La juridiction de renvoi note toutefois que malgré qu’elle ait été expressément interrogée sur cette même question (arrêt C-577/21 du 15 décembre 2022), la Cour de justice n’y a pas répondu, en raison des spécificités de l’affaire en l’espèce. |
 | RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS
Licenciements collectifs / Motif économique
L’article 1er, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 98/59/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs doit-il être interprété en ce sens que les licenciements pour motif économique fondés sur le refus par les salariés de l’application à leur contrat de travail des stipulations d’un accord collectif de mobilité doivent être considérés comme constituant une cessation du contrat de travail intervenue à l’initiative de l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, de telle sorte qu’il doit en être tenu compte pour le calcul du nombre total de licenciements intervenus ?
En cas de réponse positive à cette première question, lorsque le nombre de licenciements envisagés dépasse le nombre de licenciements prévus à l’article 1 a) de la directive précitée, l’article 2, paragraphes 2 à 4, de la directive 98/59/CE doit-il être interprété en ce sens que l’information et la consultation du comité d’entreprise avant la conclusion d’un accord collectif relatif à la mobilité interne avec des organisations syndicales représentatives, en application des articles L. 2242-21 et suivants du code du travail, dispensent l’employeur d’informer et de consulter les représentants du personnel ? |
Cour de cassation n°S 22-21.562 et n° F 22-24.197 (jonction) 05 avril 2024 Ineo Infracom C-249/24 :
Pourvoi n°S 22-21.562 et n°F 22-24.197 (ch. Soc), Ineo Infracom – Renvoi à la CJUE Aff. C-249/24
(5 avril 2024) | Dans le litige au principal, les requérants s’opposaient à la mise en œuvre par la société Ineo Infracom, d’un grand plan de déplacement, impliquant la relocalisation et la réaffectation temporaire de certains de ses employés, conformément aux dispositions issues de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Les opérations de relocalisation impliquaient notamment la modification des adresses de rattachement administratifs des requérants, lesquels ont par la suite saisi le Conseil des Prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de leur contrat de travail. Ces derniers ont par ailleurs refusé plusieurs propositions de relocalisation, transmises à la suite de la conclusion d’un accord de mobilité interne conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives. Ils ont par la suite fait l’objet d’un licenciement contre lequel ces derniers ont formé un recours tendant à l’obtention de la nullité du licenciement et dont ils ont été déboutés au stade de l’appel.
Devant la juridiction de renvoi, les requérants soutiennent que le licenciement doit être considéré comme nul et que soit constaté le non-respect de l’obligation de mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi pesant en principe sur leur employeur.
La juridiction de renvoi relève notamment que la Cour de justice à admis dans sa jurisprudence que l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, doivent être interprétés en ce sens qu’un employeur est tenu de procéder aux consultations prévues à cet article 2 lorsqu’il envisage de procéder à une modification unilatérale des conditions de rémunération susceptible d’aboutir, en cas de refus d’acceptation de la part de ces derniers, à la cessation de la relation de travail sous réserve que les conditions prévues à l’article 1er paragraphe 1 soient remplies. Elle constate notamment que le droit français applicable en la matière prévoit des conditions spécifiques autorisant l’employeur à ne pas procéder à la consultation préalable du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, lorsque l’employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours. |
 | RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS
Marché intérieur / Droits de douane / Remboursement des droits indument perçus
Le paragraphe 2 de l’article 2 du règlement 1430/79 du Conseil du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation repris par l’article 236 paragraphe 2, alinéa 3, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire doivent-ils être interprétés en ce sens
que le remboursement d’office des droits de douane perçus par une autorité douanière est enfermé dans un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte desdits droits par l’autorité chargée du recouvrement ou que l’administration des douanes doit être en mesure de constater, dans les trois ans suivant le fait générateur des droits, que les droits n’étaient pas dus ?
Le paragraphe 2 de l’article 2 du règlement 1430/79 du Conseil du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation repris par l’article 236 paragraphe 2, alinéa 3, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire doivent-ils être interprétés en ce sens
que le remboursement d’office des droits de douane perçus par une autorité douanière est subordonné à la connaissance, par cette dernière, de l’identité des opérateurs concernés ainsi que des montants à rembourser à chacun d’eux sans qu’elle ait à réaliser des recherches approfondies ou disproportionnées ? |
Cour de cassation n°R 20-20.817 18 mars 2024, dans l’affaire Caves Andorranes C-206/24 :
Pourvoi n°R 20-20.817 (ch. Com), Caves Andorranes – Renvoi à la CJUE Aff. C-206/24
(18 mars 2024) | Dans le litige au principal, la société requérante Logistica I Gestio Caves andorrannes I Vida, contestait le paiement, par l’intermédiaire d’un commissaire aux douanes, des droits de douanes imposés et indument perçus par les autorités douanières françaises sur certains produits importés en Andorre. La requérante a introduit un recours devant les juridictions françaises afin d’obtenir de l’administration des douanes le remboursement d’une somme d’un montant correspondant aux droits de douane en cause réputés indûment acquittés.
La requérante estime qu’en vertu de l’article 2 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation et à l’article 236, paragraphe 2, alinéa 3, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, les autorités douanières étaient tenues, dans de telles circonstances, de procéder à un remboursement d’office et inconditionnel des sommes litigieuses
La Cour d’Appel de Toulouse a toutefois estimé qu’un tel remboursement est conditionné à la détention, par les autorités douanières, des éléments nécessaires à la détermination du montant des droits pouvant être remboursés et à l’identité de chaque redevable, sans qu’elles n’aient à effectuer des recherches disproportionnées.
Saisie d’un pourvoi à l’encontre de la décision de la Cour d’Appel de Toulouse, la Cour de cassation, agissant en tant que juridiction de renvoi conclut au caractère inédit des questions résultant des interprétations divergentes de ladite disposition prévoyant le remboursement, par des autorités douanières, de sommes indument perçues dans les circonstances de l’espèce. |
 | RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS
Droit de propriété intellectuelle / Marque / Déchéance
Les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n’est plus le cas ? |
Cour de cassation, n°1284659, 28 février 2024 dans l’affaire PMJS, C-168/24
Pourvoi n°1284659 (ch. Com), PMJS – Renvoi à la CJUE Aff. C-168-24
(28 février 2024) | Dans le litige au principal, une société a été déchue de ses droits de propriété intellectuelle sur un ensemble de marques liés à certains produits et services dont elle a repris la production et la fourniture, à la suite de l’acceptation de son offre de reprise par le créateur originale de cette marque, laquelle était constituée de son nom.
La cour d’appel avait notamment estimé que le droit de l’Union européenne ne s’opposait pas au prononcé de la déchéance d’une marque portant sur le nom de famille d’un créateur (le cédant) lorsque, par ses manœuvres, le nouvel acquéreur (cessionnaire) de cette marque fait croire au public de manière effective que le créateur participe toujours à la conception des produits, ou crée un risque suffisamment grave d’une telle tromperie. La cour d’appel retenait ainsi le caractère déceptif des marques en cause, au motif notamment que le cessionnaire les apposait sur des produits constituant des contrefaçons des droits d’auteur du cédant, de sorte qu’une telle opération laissait croire aux consommateurs que la marque était apposée sur des créations originales du cédant.
La société requérante fait grief à l’arrêt d’appel, indiquant que « dans son arrêt du 30 mars 2006, Emanuel (C-259/04), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « le titulaire d’une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur ». Par ailleurs, elle estime que l’interprétation faite par la juridiction d’appel de la jurisprudence de la Cour en la matière, ainsi que de l’article 12 paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, devenu l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 est erronée.
Selon la juridiction de renvoi, la conclusion tirée par la cour d’appel appel de son interprétation de la jurisprudence de la Cour et des dispositions du droit de l’Union pertinente en l’espèce, pose la question de sa conformité avec l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions figurent désormais à l’article 20, sous b), de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. |
 | LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Marque européenne / Enregistrement
L’article 52 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire doit-il être interprété en ce sens que les causes de nullité de l’article 7, visées en son paragraphe 1, sous a) sont autonomes et exclusives de la mauvaise foi visée en son paragraphe 1, sous b) ?
Si la réponse à la première question est négative, la mauvaise foi du déposant peut-elle être appréciée au regard du seul motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii) du règlement n° 207/2009 sans qu’il ne soit constaté que le signe déposé à titre de marque soit constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ?
L’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 doit-il être interprété en ce sens qu’il exclut la mauvaise foi d’un déposant ayant introduit une demande d’enregistrement de marque avec l’intention de protéger une solution technique lorsqu’il a été découvert, postérieurement à cette demande, qu’il n’existait pas de lien entre la solution technique en cause et les signes constituant la marque déposée ? |
Cour de cassation, Arrêt n 1 FS-B, 12 janvier 2024 dans l’affaire CeramTec C-17/24.
Pourvoi n°H 21-23.458 (ch. Com), CeramTec – Renvoi à la CJUE Aff. C-17/24
(12 janvier 2024) | La société CeramTec GmbH de droit allemand spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de composants céramiques techniques, vendait ses produits à des fabricants de prothèses, lesquels revendaient à des utilisateurs finaux (hôpitaux, chirurgiens orthopédiques). les prothèses élaborées à partir des composants céramiques produits par CeramTec GmbH. Cette dernière a déposé trois marques européennes, la première couvrant la couleur, la seconde figurative et la troisième tridimensionnelle. La Cour d’appel de Paris a annulé les trois marques européennes, pour dépôt de mauvaise foi. La Cour de cassation, qui est la juridiction de renvoi, est donc invitée à transmettre à la Cour de justice une question préjudicielle portant en substance sur l’articulation entre les articles 7 et 52, paragraphe 1, sous b) du règlement 207/2009/CE, qui énoncent chacun des motifs de nullité absolus d’une marque. |
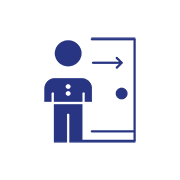 | SOCIAL
Licenciement abusif / Autorité de la chose jugée / Concentration des demandes
La juridiction d’un Etat membre peut-elle statuer sur des demandes qui auraient pu être formulées lors de l’action en justice menée au préalable par le requérant devant la juridiction d’un autre Etat membre ? |
Cour de cassation, n°19-20.538 – Renvoi à la CJUE
(8 septembre 2021) | Dans l’affaire au principal, le requérant licencié pour faute grave travaillait à Londres pour une société française aux termes d’un contrat de droit anglais. Il a obtenu devant les juridictions anglaises que son licenciement soit reconnu comme abusif. Par la suite, il a engagé en France des poursuites tendant à ce que la société lui verse des bonus, primes et autres indemnités diverses. La Cour de cassation saisie la Cour de justice de l’Union européenne afin de savoir si les articles 33 et 36 du règlement (CE) 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, permettent à une juridiction de statuer sur des demandes qui auraient pu être formulées dès l’instance initiale dans une procédure engagée dans un autre Etat membre. A cet égard, la Cour de cassation précise que les législations nationales des deux Etats membres en cause prévoient une obligation de concentration des demandes et n’autorisent donc pas aux juridictions de leur ressort de connaître, lors d’une nouvelle action, des demandes qui auraient déjà pu être formulées. Dans le cas où le règlement ne permettrait pas une telle interprétation, une action en « unfair dismissal » au Royaume-Uni et, en France, des actions en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en paiement de bonus ou de primes prévues au contrat de travail, doivent-elles être considérées comme ayant la même cause et le même objet ? |
 | CONSOMMATION
Clauses abusives / Dispense conventionnelle de mise en demeure / Délai raisonnable
Un contrat de consommation peut-il prévoir une clause claire et non équivoque de dispense conventionnelle de mise en demeure, ainsi qu’une clause qui prévoit que la déchéance du terme peut être prononcée en cas de retard de paiement de plus de 30 jours, lorsque le droit national admet qu’en cas de dérogation une exigence de respect d’un délai raisonnable doit être appliquée ? |
Cour de cassation, n° 20-12.154 – Renvoi à la CJUE
(16 juin 2021) | Dans l’affaire en cause au principal, une banque a consenti un prêt immobilier à un particulier qui a la qualité de consommateur dont le contrat prévoyait que les sommes dues étaient de plein droit et immédiatement exigibles, sans formalité, ni mise en demeure, en cas de retard de plus de 30 jours de paiement du terme principal. La Cour de cassation pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne afin de savoir si une telle clause est conforme à la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives conclues dans les contrats avec les consommateurs et si le délai de 30 jours est un délai suffisant au regard de la jurisprudence Banco Primus (aff. C-421/14). En outre, le Conseil d’Etat, sur les mêmes fondements, cherche à savoir si un retard de 30 jours peut être caractérisé comme une inexécution suffisamment grave au regard de la durée du contrat de prêt et de l’équilibre global des relations contractuelles et si les 4 critères dégagés par la jurisprudence Banco Primus sont cumulatifs et, auquel cas, s’il existe des critères alternatifs ou non plus importants que d’autres. |
 | LIBERTE D’ETABLISSEMENT ET INSOLVABILITE
Faillite / Procédure de liquidation / Effets sur l’instance en cours
La Cour de cassation demande à la Cour de justice de l’Union européenne de préciser le droit national qui doit régir, au sens de la directive Solvabilité II, les effets sur l’instance en cours devant les juridictions françaises de la faillite d’une société au sein d’un autre Etat membre. |
Pourvoi n° 19-12.048 (Inédit – 2e ch. Civ.) – Renvoi à la CJUE Aff. C-724/20
(17 décembre 2020) | Dans l’affaire au principal, une société danoise d’assurance contestait la non-constatation de l’interruption de l’instance par une juridiction française, laquelle résultait selon la requérante de l’ouverture d’une procédure collective à son encontre au Danemark. La Cour de cassation demande à la Cour de justice de l’Union européenne si l’article 292 de la directive 2009/138/CE sur l’activité de l’assurance doit s’interpréter en ce sens que l’instance en cours introduite devant la juridiction d’un Etat membre par le créancier d’une indemnité d’assurance de dommages pour obtenir le règlement de cette indemnité par une entreprise d’assurance soumise à une procédure de liquidation ouverte dans un autre Etat membre, concerne un actif ou un droit dont cette entreprise est dessaisie. Si la réponse est positive, la juridiction française souhaite savoir si la loi de l’Etat membre dans lequel l’instance est en cours a vocation à régir tous les effets de sur cette instance de la procédure de liquidation, notamment son interruption ou sa reprise. |
 | COOPERATION JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE
Compétence juridictionnelle / Successions / Désignation mandataire successoral
La Cour de cassation demande à la Cour de justice de l’Union européenne de préciser la méthode de désignation d’un mandataire successoral et la compétence des juridictions françaises, lorsque que la résidence habituelle du défunt français au jour de son décès était située au Royaume-Uni, en vertu du règlement (UE) 650/2012 relatif aux actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.
|
Pourvoi n°19-15.438 (1ère ch. Civ) – Renvoi à la. CJUE Aff. C-645/20
(1er décembre 2020) | Les requérants estimaient que la juridiction française était incompétente pour statuer sur la succession et désigner un mandataire successoral au sens du règlement, règlement non applicable au Royaume-Uni, car la résidence habituelle du défunt était située au Royaume-Uni. La juridiction de renvoi se demande si la juridiction d’un État membre dans lequel la résidence habituelle du défunt n’était pas fixée au moment de son décès doit, d’office, relever de la compétence subsidiaire prévue par l’article 10, point 1, a) du règlement dès lors que le défunt possédait la nationalité de cet État membre et y possédait des biens au moment du décès ? |
 | DROITS FONDAMENTAUX
Principe ne bis in idem / Cumul de sanctions pénales et fiscales / Dissimulation de TVA
La Cour de cassation demande à la Cour de justice de l’Union européenne si la règlementation française relative aux dissimulations déclaratives en matière de TVA qui prévoit le cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale et fiscale est compatible avec le principe ne bis in idemgaranti par l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux.
|
Pourvoi n° 19-81.929 (ch. Crim) – Renvoi à la CJUE Aff. C-570/20
(28 octobre 2020) | Dans l’affaire au principal, le requérant expert-comptable a fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal et d’une condamnation pénale par le tribunal correctionnel pour de même faits de fraude fiscale. La Cour de cassation souhaite savoir si le droit national remplit l’exigence de clarté et de prévisibilité des circonstances dans lesquelles les dissimulations déclaratives en matière de TVA due peuvent faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour. |
 | RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS
Communication de données de connexion électroniques / Autorités des marchés financiers / Délit d’initié
Le règlement (UE) 596/2014 sur les abus de marché permet-il, compte tenu du caractère occulte des informations échangées et de la généralité du public susceptible d’être mis en cause, au législateur national d’imposer aux opérateurs de communications électroniques une conservation temporaire mais généralisée des données de connexion et une remise d’enregistrements existants ? |
Pourvoi n° 19-82.223 (Inédit – ch. Crim) – Renvoi à la CJUE Aff. C-397/20
Pourvoi n° 19-80.908 (Inédit – ch. Crim) – Renvoi à la CJUE Aff. C-339/20
(24 juillet et 20 août 2020)
| Dans l’affaire au principal, des données personnelles des requérants avaient été recueillies par des agents de l’autorité administrative financière dans le cadre d’enquêtes visant des faits supposés de délits d’initié et complicité et recel de ces délits. La Cour de cassation saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin de savoir si la règlementation française permettant l’accès à des données de connexions liées à l’objet de l’enquête et la conservation de ces données pouvant se révéler pertinentes pour apporter la preuve de la réalité du manquement est compatible avec sa jurisprudence. La juridiction de renvoi demande également des précisions sur les effets de l’éventuelle réponse négative à savoir notamment si, en cas de contrariété, la législation en cause peut-elle être maintenue provisoirement afin d’éviter une insécurité juridique et permettre l’utilisation des données collectées et conservées dans l’un des buts visés par la législation sans qu’il y ait eu de contrôle préalable d’une juridiction ou d’une autre autorité́ administrative indépendante. |
 | LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT
Services de paiement / Opération bancaire non autorisée / Caution / Délai de forclusion
La directive 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur s’oppose-t-elle à ce que la responsabilité du prestataire de services de paiement puisse être engagée sur le fondement du droit commun lorsque l’utilisateur n’a pas, dans les 13 mois, contestés l’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée ? |
Pourvoi n° 17-19.441 (Inédit – ch. Com) – Renvoi à la CJUE Aff. C-337/20
(23 juillet 2020) | Dans l’affaire au principal, une banque a poursuivi la caution d’une société en remboursement d’une ouverture de crédit en compte courant qui a considéré que les virements faits à des tiers sans autorisation devaient être déduits du montant total de la créance. La Cour de cassation pose à la Cour de justice de l’Union européenne la question de savoir si l’article 58 de la directive 2007/64/CE, qui impose un délai de forclusion de 13 mois pour toute contestation d’opération non autorisée ou mal exécutée, doit être interprété en ce que ce délai est exclusif de sorte qu’un recours sur le fondement du droit commun serait impossible passé ce délai. Ainsi, dans l’hypothèse où la réponse serait affirmative, la Cour de cassation demande si la caution peut également se prévaloir d’un tel fondement. |
 | COOPERATION JUDICIAIRE
Internet / Infraction transnationale / Réparation du préjudice / Juridiction compétente
Une personne victime de propos dénigrants sur Internet peut-elle demander réparation de son préjudice moral et économique devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel le contenu est accessible, ou bien peut-elle seulement le faire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des contenus en vertu l’article 7, point 2, du règlement (UE) 1215/2012 ? |
Pourvoi n° 18-24/850 (1ère ch. Civ), Aff. C-251/20
(10 juin 2020) | Dans l’affaire au principal, un diffuseur de contenus pour adultes tchèque a engagé la responsabilité d’un concurrent hongrois devant le tribunal de commerce de Lyon. La Cour de cassation saisie la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin de savoir si la jurisprudence eDate Advertising (aff. C‑509/09) s’applique, permettant alors la réparation du préjudice devant les juridictions de chaque État membre où la pratique a pu être susceptible d’avoir un effet, ou si au contraire la jurisprudence Svensk Handel (aff. C‑194/16) doit s’appliquer. Dès lors, seule serait compétente la juridiction qui peut ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants. |
 | TRANSPORT
Présentation de documents / Enregistrement des trajets / Dérogation
La Cour de cassation demande à a Cour de justice de l’Union européenne si le règlement (CE) 561/2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route s’applique également aux infractions du règlement (UE) 165/2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers. |
Pourvoi n° 18-83.384 (Inédit – ch. Crim) – Renvoi CJUE Aff. C-906/19
(11 décembre 2019) | Dans l’affaire au principal, le conducteur d’un car a été contrôlé par les fonctionnaires de la division de la prévention et de la répression de la délinquance routière et n’a pas été en mesure de justifier de certains trajets, n’étant pas enregistrés dans le tachygraphe aux motifs que ces trajets n’étaient pas sur le territoire français et ne devaient donc pas être nécessairement enregistrés. La Cour de cassation se demande si l’article 19 §2 du règlement (CE) n°561/2006 trouve à s’appliquer uniquement aux infractions de ce règlement ou si ne pas avoir enregistré certains trajets, tels que le veut le règlement (UE) 165/2014 est une infraction également couverte par le premier règlement. Elle demande, en outre, si l’article 3 sous a) du règlement (UE) 561/2006 qui permet une dérogation à l’enregistrement sur le tachygraphe des trajets de moins de 50km permet également de déroger à l’obligation de présentation de tous les trajets sur une période de 28 jours lorsque certains trajets entrent dans cette dérogation et d’autres non. |